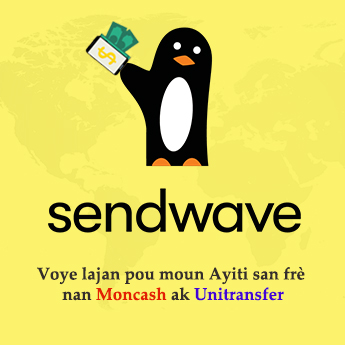Dans le milieu urbain haïtien, l’existence des femmes en surpoids et obèses – communément appelées les rondes – n’est pas un long fleuve tranquille. Dans les transports en commun, la rue voire à l’école, elles font l’objet de discriminations de toutes sortes. Critiquées, rejetées et humiliées, elles doivent livrer un combat pour s’accepter afin d’affronter le regard des autres.
« Je me rappelle une fois, je sortais de l’école. Tard dans la soirée, il pleuvait abondamment et je ne pouvais trouver de voiture pour rentrer chez moi. A un moment, un bus s’est arrêté et il ne restait que deux places à côté du conducteur. Tandis que j’ouvrais la portière pour monter, le chauffeur m’a refoulée en me disant que je suis trop grosse et qu’il n’allait pas me transporter dans sa voiture ».
Widmia Cicéron, 25 ans, journaliste et étudiante en 3e année Sciences Juridiques à l’école de Droit des Gonaïves de l’Université d’Etat d’Haïti (UEH), se rappelle fort bien de ce qui constitue pour elle, l’un des pires moments de son existence. Des instants qu’elle revit tous les jours, sous d’autres formes et avec d’autres personnages. « Je me sentais cruellement humiliée ce soir-là. Sous la pluie, je pleurais (…) J’ai beaucoup subi », confie-t-elle.
Les exemples de ce qu’a subi Widmia sont légion, que l’on considère une femme adulte ou une enfant. Placées au fond de la classe par les professeurs sous prétexte que devant elles empêcheraient aux autres de voir le tableau, écartées des filles d’honneur à un mariage, critiquées par le tailleur qui les accuse de gaspiller du tissu, disqualifiées pour un poste soit dans un bureau ou pour une manifestation artistique (film, danse), harcelées par leurs proches qui leur rappellent sans cesse leur poids et les exhortent à faire des régimes, humiliées par leurs conjoints…
Les cas sont aussi nombreux que le déni peut être profond. Car la grossophobie ordinaire demeure une réalité surtout de l’ordre du ressenti par les personnes obèses. Elle n’est pas encore perçue par la société comme la violence qu’elle représente. Cette forme de violence psychologique banalisée est également plus courante en milieu urbain.
Pas moins de 38.5% des Haïtiens sont obèses ou en surpoids, selon le rapport America Latina y el Caribe : Panorama de la seguridad alimentaria y nutricional
publié par l’Organisation des Nations Unies pour l’Alimentation et l’Agriculture (FAO) et l’Organisation Mondiale de la Santé (OMS) en janvier 2017. Parmi ces 38.5%, environ 12% sont obèses et le reste en surpoids. La prévalence du surpoids chez les enfants de moins de 5 ans est de 3.6 % en Haïti.
http://www.fao.org/3/a-i6747s.pdf
Par ailleurs, l’obésité touche particulièrement les femmes. Le taux d’obésité chez cette catégorie étant supérieur à celui des hommes. Les plus fortes prévalences se retrouvent dans l’aire métropolitaine de la capitale et le Sud – tandis que les plus faibles sont au Nord-Ouest et dans la Grand’Anse. La situation est inquiétante et la proportion ne cesse d’augmenter d’année en année dans un pays où environ 46.8% soit 5 millions de personnes souffrent de sous-alimentation.
Quelqu’un est obèse, quand il a un Indice de Masse Corporelle (IMC) – supérieur à 30 kg/m2. On parle de surpoids, pour une personne qui a un IMC compris entre 25 et 30. L’IMC se calcule en divisant le poids exprimé en kg par le carré de la taille en mètres. L’IMC ‘’normal’’ se localise entre 23 et 25.
Une violence ‘’normalisée’’ publiquement
Une enquête réalisée par Enquet’Action sur 50 femmes rondes au cours du mois de septembre 2018, a permis d’aller au cœur du phénomène. Pas moins de 50 % des personnes interviewées affirment être venues au monde obèse ou en surpoids; 100% des femmes assurent ne pas avoir cherché à prendre du poids volontairement; seulement 3% des femmes n’acceptent pas leur grosseur – contre 97% qui l’acceptent avec fierté.
Cependant, toutes les femmes interviewées affirment explicitement ou implicitement avoir déjà été l’objet de préjugés et discriminations de la part d’un proche, d’une connaissance, d’un ami ou d’un inconnu autour de leur embonpoint.
Pas moins de 27 femmes sur 50 en excès de poids assurent avoir été victimes d’humiliations dans le transport en commun de la part d’un conducteur voire des occupants qui les ont regardées de travers ou les ont traitées entre autres, de mangeuses de son de blé (porcs/truies).
Le transport en commun se dessine comme un haut lieu de discriminations contre les femmes rondes en Haïti. Très souvent, les chauffeurs de bus, taxi, tap-tap (camionnettes) et mototaxi exigent des femmes obèses ou en surpoids, le double du tarif.
« Nous ne voulons pas vous transporter pour ne pas casser notre voiture. Elle consomme quoi? », écoute-t-on souvent. Cette conception présume qu’elles occuperaient plus de sièges et seraient assez lourdes pour empêcher à l’automobile d’avancer normalement. « Si la voiture se retrouve dans l’incapacité de monter une route escarpée, on me demande de descendre. Comme pour signifier que c’est moi qui en suis la cause », se plaint Ruthjeen Cassandre Pierre, 22 ans, étudiante en Marketing et Relations Publiques.
Fritzner Lamour, 31 ans, un chauffeur de mototaxi rencontré dans les parages de la Télévision Nationale d’Haïti (TNH) le long de « l’autoroute » de Delmas, confirme l’existence de cette réalité. « La vérité c’est que, certaines fois les chauffeurs de mototaxi et de camionnette les minimisent. L’une des raisons est qu’elles donnent du fil à retorde au pare-chocs. Elles le font dilater. Le pare-chocs est un support conçu en fer, s’il porte des poids qu’il ne peut supporter, ça peut l’endommager ou causer son effondrement », prétexte-t-il.
A en croire ce conducteur, ses pairs discriminent les femmes rondes notamment parce qu’elles auraient toujours refusé de payer convenablement le tarif prédéfini pour le trajet. « Je ne les rabaisse pas – encore moins les surtaxe. Cela se pourrait que ce soit comme ça que Dieu ait créé la personne. Le Bon Dieu conçoit ses créatures avec des styles différents et une corpulence qui leur est propre », relate ce croyant qui dit voir les choses différemment des autres.
Il y en a aussi qui refusent de les transporter sous prétexte qu’elles prennent trop de place et les empêchent de maximiser leurs profits, souligne Fritzner, conducteur de mototaxi depuis trois ans.
Il affirme que la femme grosse peut prendre une place et demi voire deux. « Mais, ce n’est pas de leur faute », nuance-t-il. Pour lui, un changement de ce type de mentalité passe indiscutablement par la rééducation de la population et la sensibilisation permanente via les médias et les réseaux sociaux. « Quelque soit l’individu diminué pour quelque chose – il va se sentir fortement impacté. Il n’y a pas à sortir de là », termine-t-il.

La grossophobie made in Haïti ?
Ces attitudes discriminantes et hostiles à l’égard des personnes en surpoids ou obèses sont catégorisées ‘’grossophobie’’. Et, ça existe bel et bien en Haïti.
En français, le mot grossophobie serait apparu pour la première fois en 1994 dans le livre d’Anne Zamberlan intitulé ‘’Coup de gueule contre la grossophobie’’. Récemment, l’ouvrage ‘’On ne nait pas grosse’’ écrit par Gabrielle Deydier place davantage le terme dans l’agenda des discussions et de l’actualité. https://www.huffingtonpost.fr/2017/12/14/quest-ce-que-la-grossophobie-a-laquelle-la-ville-de-paris-consacre-une-journee_a_23307238/
La grossophobie est l’ensemble d’attitudes discriminantes et hostiles à l’encontre des personnes en surpoids ou obèses. Des agressions qui ne constituent que la partie émergée des discriminations sociales dont sont victimes les femmes en général, les femmes rondes en particulier.
Si la réalité concerne les deux sexes, les femmes sont plus souvent victimes. D’ailleurs, la rondeur chez les hommes est assimilée au pouvoir et à la richesse en Haïti. « Gwo nèg se leta », dit-on souvent ici. Rares sont les hommes qui témoignent avoir été victimes de grossophobie. Cette attitude n’est pas sans conséquences sur les victimes.
Des animosités qui détruisent !
Ces hostilités peuvent entrainer des effets sur l’enfant, l’adolescente comme sur l’adulte. Jean Robert Desrosiers, psychologue clinicien et professeur à la Faculté des Sciences Humaines (FASCH) de l’UEH qualifie de graves et néfastes, ces conséquences sur la personnalité des victimes.
« Cette situation peut entrainer des complexes, la personne se sent différente des autres dans le sens négatif du terme. Ça affecte automatiquement et gravement l’estime de soi de la personne qui se sent diminuée. C’est une situation vraiment gênante qui crée le mal-être, l’inhibition qui peut même conduire à la dépression et mener au pire. Et en fin de compte, la personne éprouve un sentiment de rejet pour son propre corps », explique le spécialiste.
Une autre psychologue abonde quasiment dans le même sens. Johanne Réfusé, détentrice d’une maitrise en psychologie de l’enfant et de l’adolescent à l’Université Paris X Nanterre, croit pour sa part que la grossophobie peut entrainer la victime à une dévalorisation de soi, un manque de confiance en soi et une grande difficulté d’affirmation de soi.
« Elle apparait comme un facteur de risque sérieux qui compromet le fonctionnement psychosocial et la qualité de vie des victimes », affirme la psychologue qui ajoute que cela peut même conduire à des problèmes pathologiques comme l’anxiété si les victimes ne reçoivent pas d’aide.
Etre stigmatisé, c’est posséder une identité dévalorisée, jugée inférieure par les autres. C’est également être acculé au bas de l’échelle sociale. La position de stigmatisé affecte grandement la valeur personnelle que ces personnes vont s’accorder. Ainsi, pour la professeure d’université, une bonne estime de soi est associée à un bien-être physique et psychologique. C’est également un indicateur d’une bonne adaptation à l’environnement.
L’estime de soi diminuera également si des personnes stigmatisées attribuent leur échec à une discrimination jugée illégitime. Une perception d’illégitimité́ rend en effet la discrimination excessivement douloureuse à vivre et préjudiciable pour la santé des stigmatisés. Ça débouchera sur des troubles psychiatriques comme des problèmes de l’humeur et problèmes de santé physique, assure la psychologue clinicienne et du développement.
Elle avance que le corps dans ce qu’il a de plus naturel en apparence, c’est-à-dire dans les dimensions de sa conformation visible (volume, taille, poids, etc.), est un produit social. Ainsi, les individus construisent leur estime de soi notamment à̀ partir de l’image que leur renvoient des personnes «signifiantes » (essentiellement la famille ou le groupe social de référence).
« Tous les individus, stigmatisés ou non, vont donc recourir à̀ diverses stratégies psychologiques pour construire, maintenir et protéger leur estime de soi », dit-elle. Ces stratégies sont : la comparaison avec d’autres individus stigmatisés plutôt qu’avec les dominants, l’attribution de ce qui arrive aux préjugés et/ou à la discrimination des dominants plutôt qu’à soi-même et le désengagement sélectif c’est-à-dire dans les domaines où les individus stigmatisés sont menacés.
AUDIO : « La grossophobie peut entrainer la victime à une dévalorisation de soi», Johanne Réfusé, Psychologue
Vivre et s’habiller, un calvaire …
« J’ai failli me suicider, tellement que j’avais le moral à zéro », confie Sabrina Petit Homme, 28 ans, l’une des rares rondes chanteuses en Haïti. « Avant c’était un lourd fardeau et un grand défi », ajoute celle qui se trouvait dans une relation sentimentale difficile, rompue en raison de sa rondeur.
Dans ce même milieu où les rondes sont décriées, on retrouve des personnes qui les tolèrent. Cependant, ceux et celles qui sont là pour décourager ces femmes seraient plus nombreux que ceux et celles qui les encouragent et aident à surmonter les défis.
 L’un des grands défis que confrontent les rondes, c’est de trouver des tenues à leur taille dans les shop et magasins qui sont pourtant bourrés de vêtements pour les femmes dites normées. Ce qui représente pour elles, le désavantage d’être ronde. Un problème qu’évoque 15 sur les 50 femmes interrogées.
L’un des grands défis que confrontent les rondes, c’est de trouver des tenues à leur taille dans les shop et magasins qui sont pourtant bourrés de vêtements pour les femmes dites normées. Ce qui représente pour elles, le désavantage d’être ronde. Un problème qu’évoque 15 sur les 50 femmes interrogées.
« Gen ti rad ou anvi mete, ou paka jwenn ladan’l (Il est impossible de trouver des tenues qui nous tentent) », se plaint Allendie St Jean Adolphe, 32 ans, dont la plupart des amies sont rondes. Il ne manque pas uniquement des vêtements et sous-vêtements spéciaux dans un design ou une collection spécifique, mais globalement des vêtements ‘’grande taille’’.
« L’unique fois que je suis consciente de ma véritable grosseur – c’est quand je dois me procurer de pantalons jeans. C’est à ce moment-là que je réalise que je dois me rendre dans un magasin à part destiné aux filles de ma taille. Ce qui me fait sentir que je fais partie d’une catégorie spéciale », se plaint de son côté Emmanuela Roberte François, 25 ans, qui réalise actuellement un baccalauréat en études de conflits au Canada. Cette situation, elle le qualifie de « subtilement » discriminant. « Evidemment, à ce moment je critique l’industrie de la mode qui parait inégalitaire ».
Pour vérifier ces allégations, Enquet’Action s’est rendu à Delmas 2000, un des plus grands magasins de la région de Port-au-Prince, où l’on trouve presque tout, dont des tenues pour hommes et femmes. Sur place, nous avons remarqué majoritairement des vêtements pour femmes minces et presque pas de vêtements « grande taille ». Une employée rencontrée devant les comptoirs où sont logées les lignes d’habillements pour femmes – se confie à nous, sans langue de bois.
« Nous en n’avons pas. Parfois, des personnes en surpoids y viennent et trouvent. (…) Épisodiquement, le patron apporte et on en trouve ici. Autrefois, nous en avions. Le patron a remarqué que la vente de ces habits n’est pas alléchante (yo manke vann cho), il a été obligé d’envoyer des vêtements sexy (pour femmes minces) », clarifie-t-elle.
Elle admet la nécessité d’en avoir vu la quantité de personnes obèses dans le pays.
« La situation est telle dans presque dans tous les shop », ajoute-t-elle, assurant qu’elle risque ne pas en trouver considérant sa grosseur. Pourtant, elle n’est pas obèse encore moins en surpoids. « Vous ne voyez pas que ce sont des habits ‘’sexy’’ – des habits pour mannequin ? Ce ne sont pas tous ces habits qui me siéent ».
En Haïti, nombreuses sont les personnes qui achètent les tenues de seconde main communément appelé pèpè – considérant leur prix peu onéreux par rapport à celles des magasins – dans un pays où l’écrasante majorité des habitants vivent dans la pauvreté.
Ainsi, avions-nous rencontré – une parmi les dizaines de marchandes de vêtements usagés (pèpè) qui apposent leurs habits, le long du mur longeant le magasin Delmas 2000. « Elles en trouvent parfois. Des fois elles viennent, mais n’en trouvent pas. Parfois, vous trouvez [aussi] des femmes portant le 20, 26 qui viennent et vous ne trouvez pas ceux qui conviennent à leur size », déclare-t-elle, entourée d’autres, occupant arbitrairement le trottoir aux cotés des voitures et passants.
« Il y a des modèles d’habillement qu’elles aimeraient porter – mais pourtant qui sont difficiles à trouver dans leur size », argue-t-elle. « Les femmes en surpoids le plus souvent ne donnent pas de prix raisonnables pour les vêtements. Elles vous disent toujours que si ce ne sont pas elles, les rondes qui les achètent – personnes d’autres ne vont le faire », continue cette commerçante. Ce qui parait renforcer davantage la réputation d’avaricieuse collée au dos des femmes en excès de poids. Dans le paquet (bal pèpè) – on trouve toutes les dimensions.
Mais on trouve davantage pour les sexy, reconnait cette femme qui assure prendre soin de sa famille – composée de six enfants – convenablement grâce à cette activité économique qu’elle exerce depuis 14 ans. Sa stratégie, se procurer des habits qui se vendent rapidement (rad ki vann cho) et refuser ceux qui vont rester longtemps.
« Il est difficile pour les femmes obèses et en surpoids de trouver des tenues qui leur conviennent », conclut-elle. « Les habillement sexy se vendent beaucoup plus vite. Ce n’est pas le cas pour les habillements plus size», dit-elle pour justifier son étalage fait majoritairement d’habillements « sexy ».
Haïti, l’invasion du diktat de la minceur ?
Pour Auguste D’Meza, sociologue et professeur d’université, cette conception du corps est une création pure et simple de l’occident blanc. La question de la grossophobie ne se pose que dans les grands centres urbains. En Haïti, elle n’est qu’une construction sociale récente.
« On nous a toujours imposé un référent culturel et esthétique lié à l’occident blanc. Il faut de petites lèvres, des nez aquilins, les cheveux lisses, des fesses non redondants et non rebondis, de petits seins ou des seins moyens. Ce qui fait que, nous développons un regard sur la femme noire issue d’une culture essentiellement occidentale », martèle le professeur.
Dans le milieu rural haïtien, la rondeur est appréciée et choyée. Mais, le sociologue n’écarte pas la possibilité qu’au fil du temps cette hostilité envers la rondeur ne s’infiltre en milieu rural, comme cela se fait pour le raboday (style de musique qui dénigre surtout les femmes) qui gagne depuis un certain temps des espaces où se jouait la musique traditionnelle. « En milieu rural, si la femme n’est pas redondante, n’a pas de fesses rebondies et des seins d’une certaine dimension, elle ne trouvera pas partenaire. On dira d’elle qu’elle est malade – qu’elle est tuberculeuse, qu’elle a le sida, qu’elle sort dans un milieu pauvre », croit-il.
Il voit dans cette question de grossophobie une forme d’hypocrisie mêlée à une forme d’instrumentalisation du sexe de la femme. Car, ceux et celles qui apprécient le corps rond – le sont majoritairement que pour ses valeurs sexuelles, mais ne voient pas la personne dans sa totalité. « Ce culte de la minceur s’est développé dans le milieu urbain et particulièrement dans le milieu urbain aisé. Le problème n’est pas posé en milieu rural, explique le consultant en politique et en éducation. La femme noire n’a pas la même morphologie que la femme blanche. [En général, elle] a des lèvres épaisses et des fesses rebondies et parfois de gros seins ».
Pour lui, les médias et la publicité sont grandement responsables de l’arrivée jusque vers nous de cette manière de voir les gens. Ainsi, plaide-t-il pour le contrôle et l’interdiction de certaines publicités et dénonce le fait qu’on diffuse n’importe quoi dans les médias haïtiens à n’importe qu’elle heure, sans que personne n’ose lever le petit doigt. « Il y a certains stéréotypes qui n’auraient pas dû être véhiculés soit par des émissions – soit dans des vidéos. Quelque soit le pays au monde, les médias ne peuvent véhiculer n’importe quel message », dit-il.
Ce qui expliquerait la multiplication des clubs de gym dans la région de Port-au-Prince. Derrière cette stratégie de multiplication, la nécessité de faire du sport pour rester en santé ne serait pas le principal mobile, mais plutôt la construction d’un corps « normé » suivant les canons qu’offrent les médias. « C’est la même chose pour le culte de la minceur. Le culte de chasser le surplus de poids qui existe dans la classe aisée est de plus en plus maintenant imitée par les filles qui vivent dans les milieux à revenu faible ».
VIDEO : « Le mythe de la grosseur ne fait pas partie de la culture haïtienne », Auguste D’Meza, Sociologue
Le déclic : Acceptation de soi !
« Etre ronde, c’est mener un combat quotidien dans la société pour pouvoir s’imposer et y vivre [convenablement]. Je m’accepte et j’accepte ma rondeur. Sinon, je serais toujours déprimée et je mènerai une vie de merde », livre Wisline Louissaint, 29 ans, journaliste et communicatrice sociale. Elle ajoute que, pour pouvoir rester en bonne santé et non plaire, elle s’attèle à perdre du poids.
« Il faut avoir un moral d’acier pour parvenir à s’accepter et vivre sa rondeur pleinement », continue-t-elle. Elle admet que sa surcharge pondérale vient tout naturellement. Malgré tout, Wisline continue de lutter contre les remontrances des uns et autres. « Dans mon entourage, certains m’acceptent. D’autres non. Ceux qui ne m’acceptent pas me traitent tellement mal que parfois j’ai envie de perdre confiance en moi », renchérit Mickerlange Emmanuel, 25 ans. « Cela m’attriste. Des fois, je pleure ».
Pour Emmanuela Roberte née et issue d’une famille en surpoids, les discriminations qu’elle a connues dans le passé, constituent des moments sombres de son existence. Elle se rappelle d’un membre de son église qui l’invitait tôt le matin à aller faire du sport, des régimes qu’elle essayait de faire en vain, des personnes qui lui disaient qu’elle était grosse comme un bœuf et l’internaute qui la faisait croire qu’elle n’a pas un corps capable de porter un style spécifique de bikini.
« Tous ces souvenirs font désormais partie du passé. Je m’assume. J’aime chaque ligne et courbe de mon corps qui fait que l’autre apprend à m’aimer comme je suis », affirme-t-elle, ajoutant que le stress et la mauvaise alimentation qui marche avec ont surtout contribué à sa prise de poids. « Il y a des personnes qui font du sport et sont bien nourries qui n’arrivent jamais à devenir minces. Elles n’ont pas le métabolisme et le gène pour cela », explique-t-elle.
Les régimes minceur ne fonctionnent pas toujours. Des femmes ont tout essayé (régimes, thé, recettes de grand’mère, les gym, etc.) et ne sont pas parvenues à être cette femme « normée » aux yeux de la société. L’obésité ou le surpoids est lié à l’alimentation, mais est aussi, parfois une question génétique. Des femmes ont par ailleurs pris du poids après une grossesse, à la suite des premières règles, la prise de contraceptifs, le stress, etc.
Avec le temps, la grande majorité des victimes disent arriver à sortir de cette situation où elles se laissaient prendre dans l’engrenage des jugements et critiques de leurs proches et de leur entourage. Avant de s’accepter, les filles répondaient aux discriminations verbales avec des injures, des larmes, le découragement, etc. Après le déclic, elles font peu cas des remontrances. Elles les méprisent. Elles en rient.
« Je parvenais difficilement à accepter ma grosseur à des moments où je recevais souvent des remarques sur ma prise de poids qui m’ennuyaient beaucoup. J’étais toujours sur la défensive parce qu’on me lançait toujours des propos répugnants », se rappelle Emmanuela. D’ailleurs, elle ne fait plus cas des remarques des autres, même si elle reçoit souvent des commentaires dégradants de ses proches relatifs à son poids sous ses photos sur Facebook.
L’existence d’Emmanuela montre bien que les critiques font beaucoup plus de dégâts quand la personne victime manque d’assurance en elle. Ce qui la fait se sentir inconfortable dans son propre corps.
Accepter la différence, c’est ce qu’elles font afin de chasser les complexes. Après ce moment de déclic, elles disent se sentir bien dans leur peau.
« Quand nous étions plus jeunes, nous tenions à suivre la mode. Des fois, l’envie d’être sexy (mince en créole) nous vient en tête et nous pousse à suivre tous les types de régimes. Mais avec l’âge, le travail qui est fait en nous, notre estime de soi nous permet de comprendre ce que nous sommes véritablement et de valoriser nos potentialités. Ce qui nous fait saisir la nécessité de garder ce cap », martèle Aristil Valencia, 33 ans et étudiante en Anthropo-sociologie à la Faculté d’Ethnologie de l’Université d’Etat d’Haïti. « Autrefois, j’étais toujours remontée. Mais pour l’instant, cela ne m’ébranle plus. Je me sens bien dans ma peau. Je suis belle ».
Globalement, ces femmes ne considèrent pas leur poids comme un handicap contrairement aux idées préconçues véhiculées dans la société. Elles sont bien dans leur peau et à l’aise avec leur corps. Contrairement à ces clichés sociaux, elles s’estiment capables de faire tout ce qu’une femme mince est capable de faire voire beaucoup plus. « Je peux danser, courir, sauter et porter les habits qui me font plaisir », assure Sabrina, chanteuse.
« Tout janw abiye fèw byen (Qu’importe le vêtement que vous portez, vous paraissez coquette – en français)», des propos qui reviennent souvent au cours de notre enquête.
Si une bonne partie parvient à s’accepter, il existe tout de même, une minorité qui n’arrive toujours pas à s’en sortir. Et, au nombre de cette catégorie se retrouve Medgine Sylvain, 30 ans, institutrice.
« Quand je marche dans la rue, ce ne sont pas toutes les paroles lancées à tout bout de champs qui me plaisent. Certaines personnes m’acceptent et m’aiment comme je suis. D’autres, pour autant ne me tolèrent pas et ne cessent d’exiger que je fasse du sport. Quand ils me voient, ils rient à gorge déployée en disant : woy gad gwosè yon moun, tu ne sens pas que tu es trop grosse. Cesse de manger (sispann manje !)», déplore-t-elle. « Mwen konn fache et mwen jis pa okipe yo. Je suis toujours munie de mon casque pour écouter de la musique afin ne pas entendre les critiques. C’est un manque flagrant de respect ».
La résilience est le concept clé utilisé par le psychologue Desrosiers pour expliquer le déclic chez les femmes qui parviennent à s’accepter. Il le définit comme étant cette capacité de rebondir après une chute. « On n’a pas tous la même capacité de résilience. Cette capacité de l’individu à résister et à rebondir face aux épreuves de la vie », insiste-t-il.
De son côté, la psychologue Mme Refusé soutient que tout excès de poids ne justifie pas de façon univoque une perte de poids. Les causes peuvent être multiples : comportementales, psychologiques, sociales, métaboliques, hormonales et toxiques. « La prise de poids ou une reprise de poids, c’est un facteur important du mésestime de soi. D’autant que le regard des autres ou la perception du regard des autres peut renforcer cette idée négative. C’est également un facteur d’autodépréciation », dit-elle.
Le comportement alimentaire s’inscrit dans une psychopathologie où la prise de la nourriture est une réponse comportementale à des angoisses, des pulsions et des états dépressifs. Donc, le régime représentera une tentative inutile voire toxique de résoudre le surpoids, soutient la professeure.
Résister pour faire face aux discriminations
« Etre ronde, c’est un combat quotidien dans une société comme la nôtre », affirme de son côté la journaliste Janeley Mikhaïlov Patricia Roger, 27 ans, journaliste et maquilleuse professionnelle. Elle fait de son mieux quotidiennement pour gagner ce dur combat. Toute petite, elle fondait souvent en larmes dans les bras de son père après avoir essuyé des humiliations en raison de sa grosseur. « C’était un dur combat qui a failli me coûter la vie ».
Actuellement, celle qui se fait surnommer – Jane la ronde à force d’être fière de ses courbes, s’accepte totalement. « Je vis ma rondeur avec beaucoup de grâce. Je ne me suis pas laissée abattre », dit-elle.
AUDIO : « Etre ronde, c’est un combat quotidien dans une société comme la nôtre », Jane la Ronde
« Etre ronde, veut dire beaucoup pour moi. Ça veut dire que j’ai ma place dans ce monde. Ça traduit pour moi le courage. Je suis grosse et belle, c’est ma plus grande fierté ! », persiste-t-elle dans ce témoignage poignant qui résume pleinement la condition d’existence des femmes rondes.
Si Enquet’Action est le premier média haïtien à avoir enquêté sur le sujet, Janeley a le mérite d’être l’une des rares journalistes à l’avoir traité. Une situation qu’elle décrit de fort belle manière dans un reportage inédit réalisé pour un média de la capitale. « Les femmes rondes sont traitées avec beaucoup d’indifférence. Elles sont pointées du doigt partout et mis à l’écart dans la société », relate-t-elle dans ce reportage.
AUDIO: Grossophobie Made in Haïti
https://soundcloud.com/enquetaction/grossophobie-made-in-haiti
Il appert que la grossophobie ait la vie dure dans le milieu urbain en Haïti. Pour résister face à une société qui les discrimine, les femmes victimes se créent leur propre monde. Une bonne partie d’entr’elles se soignent, portent des habits qui leur conviennent et s’investissent en elles. Mais aussi, se mettent en valeur et cultivent leur estime de soi (kwè nan tèt yo (confiance en soi !) et prennent leur éducation au sérieux.
Ainsi, retrouve-t-on des agences, concours de beauté, miss, shows de danse, pages facebook et instagrams, défilés de mode et castings …. Valorisant la femme ronde, les aident à reprendre confiance en elles et à mieux gérer leur santé non pour plaire aux autres, mais pour faire plaisir à soi-même.
La rondeur est classe ! Fière d’être ronde ! – des slogans récurrents dans cette communauté où la fierté va tellement loin que certaines femmes ne s’imaginent pas dans un corps mince.
Avec les femmes obèses et en surpoids en Haïti, rondeur symbolise la fierté, le courage, la solidité, la combattivité, la vigueur et la force. La rondeur est synonyme de beauté, de sourire, d’élégance, d’unicité, de merveille et de bénédiction.
« Sa fèm santim fanm (Je me sens femme dans le sens plein du terme – en français », disent-elles.
Alors que certaines plaident pour la fin de ces discriminations et préjugés, d’autres de leur côté promeuvent l’auto valorisation. Dacheley Estimé, 24 ans, journaliste et étudiante en psychologie – est une adepte de cette seconde idée.
« Si vous êtes une femme ronde et que votre entourage refuse de vous accepter telle que vous êtes, c’est parce que vous-même, vous refusez de vous accepter. Vous devez avoir confiance en vous-même pour ne pas laisser aux autres l’opportunité de vous humilier. Armez-vous de style. Faites-vous élégantes quand vous vous habillez. Ne vous négligez pas à l’instar de quelqu’un qui est désespéré. Déambulez avec fierté et marchez la tête haute. Pour finir, pratiquez des exercices physiques pour rester en bonne santé ».